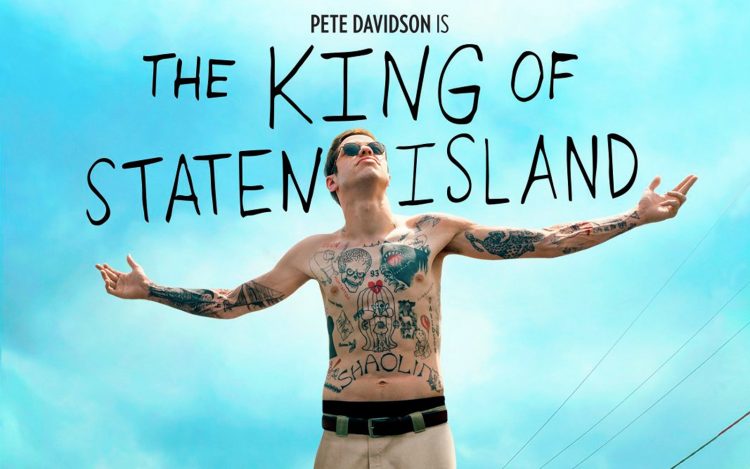PAS COMPLETEMENT AUX ABONNES ABSENTS : D’UN CERTAIN CINEMA AMERICAIN….
Depuis la réouverture des cinémas au tout début de l’été dernier, on a beaucoup incriminé l’absence de films américains pour expliquer la chute des entrées en salles. Or, si il serait difficile effectivement de nier aujourd’hui la dépendance de notre exploitation au marché d’outre atlantique et à ses « blockbusters », quasi aux abonnés absents cet été, Tenet de Christopher Nolan excepté… Il y a pourtant bien eu quelques films américains qui sont sortis en salles sur juillet / août – et parfois pas des moindres ! – quand bien même ils auraient réalisé très peu de recettes !
UNE PETITE PRESENCE PAS NEGLIGEABLE DU CINEMA INDEPENDANT (IRRESISTIBLE ; NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS ; THE VIGIL)

Dès le 1er Juillet, Irrésistible, une satire politique interprétée par Steve Carell se risquait timidement dans une combinaison de salles très réduite. Cette comédie signée par l’ancien humoriste Jon Stewart nous rappelait déjà que les films américains existaient toujours bel et bien, tout en pointant effectivement leur désertion, rapportée à leur frange la plus « mainstream », voire à leurs productions les plus rentables.
Irrésistible ne fit pas une grosse carrière, très vite relégué au bout de quelques semaines à une seule journée de projection (pardon ?) au cinéma UGC Ciné Cité des Halles… Malgré quelques réserves côté casting – le personnage interprétée par Rose Byrne, hyper vachard, aurait gagné à être bien plus développé – question analyse politique actuelle, Irrésistible en a suffisamment sous le capot : tant sur ce plan, on ne s’étonne aujourd’hui plus de rien, et pas seulement aux USA ! La conclusion assez surprenante de cette satire très mal accueillie dans son pays d’origine, est malheureusement aussi surtout très actuelle : pour ne rien dévoiler de son générique final, qui joue les prolongations avec une rare inventivité… A quelques mois des élections américaines, il est dommage que cette sortie trop discrète n’ait pas trouvé davantage de supporters ! Que les résultats soient à priori aujourd’hui connus ne constitue pas non plus une raison supplémentaire de la bouder…
Au rayon des « petits films indés », l’on aurait bien aimé être davantage emballé par le troisième long-métrage d’Eliza Hittmann, Never Rarely Sometimes Always, sur le droit à l’avortement, pas rentré dans les mœurs à l’identique dans tous les états « unis » d’Amérique. Et ce, malgré la justesse du regard documentaire porté sur une situation aussi mal connue que douloureuse, pour ne rien dire de l’interprétation parfaite de tous les comédiens : en premier lieu desquels l’actrice principale, Sidney Flanigan, de tous les plans pour ainsi dire, qui porte littéralement le film sur ses épaules… Cette légère déception ne nous empêche pas pour autant d’attendre avec une certaine impatience l’ouvrage précédent de la réalisatrice, toujours pas sorti dans nos contrées, sauf en DVD le 15 mars dernier : Prix de la mise en scène au festival de Sundance en 2017, Les bums de plage semble se dérouler à des années lumières du naturalisme un peu étouffant du drame, certes d’utilité publique, que nous propose de suivre Never Rarely Sometimes Always…
Enfin, pour les fans de films d’horreur, la fin du mois de juillet aura peut-être été marquée par The Vigil de Keith Thomas, lequel se pose très clairement comme un cinéaste à suivre. Se déroulant le temps d’une nuit, The Vigil accoutume les non-initiés à la tradition hassidique de « shomer », consistant pour l’heureux élu… à veiller un mort jusqu’à l’aube.
Faisant de pauvreté vertu, Keith Thomas compense un manque de moyens évident par énormément d’idées, une inventivité quasi constante. Au point de nous faire songer dans ses plus grands moments à un cinéaste dont on reste sans nouvelles depuis un long moment : lequel a réalisé lui aussi par le passé quelques très grands films nous plongeant dans une nuit qui dure (la nôtre ?), avant comme c’est le cas ici, de nous ramener in extremis vers la lumière…
Evidemment, une expérience aussi intense du noir appelle de ses vœux, requiert la salle de cinéma plus que tout autre support, afin d’atteindre son efficacité maximale et foutre vraiment les jetons !
VRAIMENT PAS NEGLIGEABLE, CETTE PRESENCE…LA PREUVE PAR TROIS !
Outre le fait que Dawson City : le temps suspendu reste bien un documentaire conçu lui aussi sous la bannière étoilée (manière d’affirmer tout de go – cf. précédent papier – que le meilleur doc à être sorti en salles l’été dernier est aussi un film américain), juillet tout comme août auront tous deux respectivement été marqués par deux titres US majeurs : The king of Staten Island de Judd Apatow et Light of my Life de Casey Affleck. Si l’on ajoute à ces deux derniers comme trait d’union la découverte inattendue toute fin juillet de The Climb, premier long signé Michael Angelo Covino, force est de constater que « l’autre cinéma américain » était loin d’avoir totalement déserté les écrans l’été dernier…
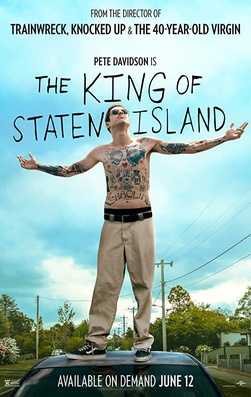
1) THE KING OF STATEN ISLAND
La dernière comédie mélancolique de Judd Apatow est donc sortie dans les cinémas français le 22 juillet dernier, trois semaines après Irresistible (cf. voir plus haut). Entre ces deux là, aucune production US ne s’est risquée à reprendre le chemin des salles obscures, exception faite du bien nommé Scooby ! : animation qui aura tout de même réussi à tenir l’affiche tout l’été, avec des séances aménagées pour le jeune public…
L’on ne sera guère surpris de découvrir qu’Irrésistible et The King of Staten Island ont tous deux été distribués par la même compagnie, à savoir Universal : laquelle avait adopté comme stratégie de sortir, en l’absence remarquée des habituels « mastodondes », des ouvrages plus fragiles qui n’auraient pas forcément eu droit à une telle exposition en salles en temps normal… Louons la beauté du geste, car la dernière réalisation d’Apatow, bien qu’elle ait bu apparemment hélas la tasse, possède à peu près la même ampleur que son Funny People !
Film singulier, résolument à part dans la production américaine contemporaine, The King… n’est pas toujours très « fun », même si encore une fois l’humour est bien présent, au travers de vannes terriblement bien envoyées. Cette méga tranche de vie est surtout transcendée par son interprète principal, Pete Davidson (stand upper découvert par Apatow sur sa comédie précédente Crazy Amy, qui a gagné fortement en notoriété depuis). Ayant lui-même perdu son paternel pompier lors des attentats du 11 septembre, Davidson rejoue en quelque sorte ici à l’écran la part sans doute la plus intime de sa vie. The King of Staten Island, ou comment transformer une comédie au départ brinquebalante en opération à cœur ouvert, en prenant comme point de départ la « vraie vie » de son personnage principal…
Mené avec une vraie science du récit, cette fiction donc très poreuse s’avère être de ce fait une œuvre particulièrement attachante, à tel point qu’il faudrait presque redéfinir ce concept d’ « attachement » en (re)partant de ce film : notamment de l’effet qu’il provoque insidieusement sur la durée, dont il sait faire une savoureuse alliée malgré ses 137 minutes « bien frappées ». Cela faisait un sacré bail que l’on ne s’était pas senti aussi bien devant une œuvre cinématographique, de par cette impression grandissante d’être tout simplement « en bonne compagnie » : sans doute parce qu’Apatow cultive un amour à peu près égal pour les gags… et l’humanité en général.
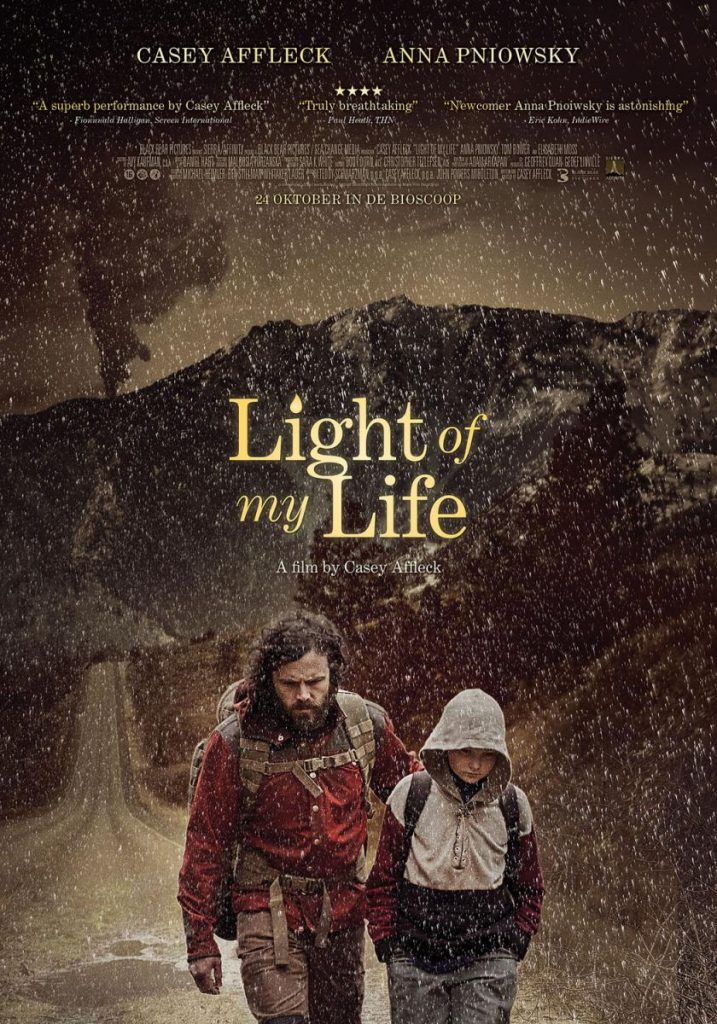
2) LIGHT OF MY LIFE
Août aura été certes plus chiche en matière de sorties US : on retiendra juste le 12 du même mois l’inattendue première fiction crépusculaire de Casey Affleck, Light of my Life. Lancé dans un circuit un peu trop gros pour lui, en l’absence de quasi toute concurrence, cette dystopie apocalyptique aura sans doute beaucoup souffert du contexte anxiogène au sein duquel elle nous est parvenue…
Construite sur le fil d’une intrigue très ténue, cette errance d’un père obsédé par la protection de sa fille devient de plus en plus prenante : sans doute là encore parce que l’on sent chez Affleck, tout comme chez Apatow, une identique nécessité impérieuse de nous faire partager un projet qui semble provenir du fond de leur coeur.
On se méfiait pourtant bien à l’avance de l’aspect sentencieux et interminable de ce genre de projection futuriste : ne serait ce que pour s’être énormément ennuyé devant l’adaptation lourdaude de La route par John Hillcoat. Après une scène d’ouverture très verbeuse qui pouvait faire craindre effectivement tous ces travers, Light of my Life n’aura fort heureusement de cesse de nous impressionner, sans recourir au moindre effet de manche, en prenant le parti de la sobriété.
Esthétiquement déjà assez renversante – donnant l’impression d’être éclairée parfois en intérieur à la bougie – cette œuvre fantomatique parvient très rapidement à installer son monde pré-apocalyptique, avec comme composante un virus qui décime essentiellement la population féminine… Et cet univers modifié de moins en moins rassurant, l’acteur / réalisateur le rend crédible avec finalement très peu de moyens.
Au travers de sa petite odyssée luttant perpétuellement pour assurer sa survie propre, Affleck parvient même à nous glacer le sang à plusieurs reprises : notamment dans les scènes finales assez effrayantes, où le cinéaste semble se souvenir de cette leçon assénée par Hitchcock dans son pourtant très dispensable Torn Curtain… A savoir que tuer un homme peut prendre du temps : voire énormément de temps, lorsque l’on est assailli de toutes parts comme c’est le cas ici, en devant se battre à mort pour éviter à n’importe quel prix la sienne propre !
Le final, forcément apaisé après une embardée aussi terrifiante, n’est pas pour autant rassurant, mais nous encourage à « vivre avec » une situation pandémique : écho lointain mais néanmoins troublant, rapporté à la période que nous traversons tous actuellement dans un tout autre genre. Un contexte qui ne risquait guère de permettre à ce film à la rugueuse beauté de réaliser beaucoup d’entrées, en dépit du label « CIP » qui lui a été décerné, et qui aurait pourtant pu l’aider dans cette tâche… Cette vision très pessimiste d’un possible monde à venir s’est malheureusement prise une grosse veste, tout en tombant finalement terriblement à pic !

3) THE CLIMB
Sorti toute fin juillet, The Climb de Michael Angelo Covino restera comme une des plus belles découvertes de l’été dernier, et comme plus sérieuse figure d’ « outsider » à atteindre les plus hautes marches du podium, afin de se faire une place méritée entre The King of Staten Island et Light of my Life.
Présenté à la section « Un certain regard » à Cannes en 2019, The Climb y fit forte impression, en remportant les faveurs du jury. Rebelote au Festival de Deauville quelques mois plus tard où cette « extension » d’un court-métrage déjà remarqué repart à nouveau avec le Prix du Jury… Ce premier essai, dont la belle étrangeté n’a d’égale que son étonnante réussite, désarçonne quasi constamment le spectateur, qui ne sait jamais finalement jusqu’au bout sur quel pied danser. C’est qu’à l’image de sa BO très… « Gilbert Bécaud », le premier film de M.A. Covino semble cultiver l’art de la surprise comme une seconde nature.
Il faut dire que The Climb ne ressemble pour ainsi dire à rien de connu sous nos latitudes : tout en suivant sur dix ans une histoire d’amitié masculine qui pourrait se réclamer du genre typiquement américain de la « Bromance ». Difficile également de le rattacher au cinéma français de la Nouvelle-Vague dont son auteur semble vouloir davantage se réclamer côté influences personnelles… Cependant, de par son incroyable tour de force formel, The Climb pourra faire penser de loin – et encore – à… Encore (Once More) de Paul Vecchiali, infatigable créateur de formes lui aussi : on retrouve en effet dans les deux cas un même recours à l’ellipse ainsi qu’au plan-séquence pour raconter une décennie entière d’expériences et de trajectoires de vies.
Ce qui fait en outre vraiment plaisir à voir ici, c’est cette image de la virilité contemporaine progressivement écornée par deux mâles de moins en moins formatés, à la corpulence un peu bedonnante, voire parfois même beaucoup… Et comment aussi sur une dizaine d’années, cette amitié aussi vache que maladive, qui semble résister à toutes les épreuves du temps, se métamorphose – à notre insu, là encore – en une forme supérieure d’amour (?). The Climb ne cesse finalement de nous prendre à témoin de cette « passion » dévastatrice et inconsidérée, qui finit par anéantir tout ce qui pourrait la faire dévier de la route escarpée qu’elle s’est décidée initialement à gravir : superbe scène d’ouverture, reprenant apparemment le court-métrage à l’origine de l’œuvre, tourné sur la Côte d’Azur …
Rares sont les films – à plus forte raison de grands débutants – qui jouent à des jeux aussi troubles en questionnant le masculin : à tel point qu’arrivé à la scène finale, on se demande si l’on n’a pas tout bonnement halluciné la totalité du spectacle auquel on vient juste d’être convié ! Et c’est peu de dire qu’on attend la suite avec une certaine impatience…